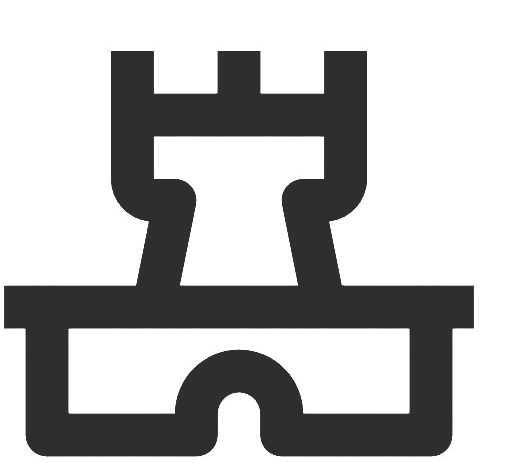Valorisation des algues vertes, une chimère qui nous coûte cher

Dans les épisodes précédents :
- Début 2025, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a confié à M. Mickaël Cosson (Dem, Côtes-d’Armor) et M. Olivier Serva (LIOT, Guadeloupe) une mission d’information flash sur la valorisation des algues en réponse à leur prolifération.
- Le 31 mars notre association a accepté d'être auditionnée pour ne pas laisser le champ libre à l'idée que les marées vertes pourrait être "l'or vert" que plusieurs acteurs s'attellent à vouloir faire croire depuis 40 ans.
- Le 30 avril, les deux corapporteurs, ont présenté à la la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire les conclusions de la mission, un document de synthèse est alors mis en ligne, document dans lequel les élus se contente d'affirmer "Aucun des acteurs que nous avons rencontrés n’affiche de certitude absolue quant aux résultats futurs, mais tous ont la volonté d’y travailler" ne reprenant ainsi aucun des nombreux arguments développés par notre association, au contraire ils balaient les éléments de leurs contradicteurs par ce propos : "Nous ne contestons pas cette approche, mais nous rappelons que l’agriculture des Côtes-d’Armor a déjà réduit de moitié ses intrants. Les progrès futurs risquent d’être plus lents.".
- Le jeudi 19 juin, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet s’est rendue sur les terres du député Mickaël Cosson, pour aborder l’épineuse question des marées vertes. La presse locale titre : « Arrêtons de considérer cette filière comme un déchet » : et si les algues vertes n’étaient « pas qu’un problème » ?
A la suite de ce qui apparait de plus en plus comme une énième opération de communication des tenants du statut quo en matière de lutte contre les marées vertes Eau et rivières de Bretagne et sa fédération Régionale France Nature Environnement Bretagne, soutenues par 4 associations locales ont décidé d'écrire à la Présidente de l'Assemblée nationale pour porter à se connaissance leur mécontentement dans la manière dont cette question a été traitée par la Mission parlementaire. Retrouvez ici la lettre ouverte qui vient de lui être adressée alors même que la Bretagne fait face à l'une des saisons les plus prolixes sur le front des marées vertes.
Retrouvez ci-après l'intégralité de l'actualité publiée par Eau et rivières à l'issue de l'audition du 31 mars.
Lors de son audition par la mission parlementaire le 31 mars dernier l’association a rappelé que les « marées vertes » en Bretagne ne sont que le marqueur bien visible d’une pollution systémique dont les effets sur les cours d’eau et les eaux littorales sont bien plus importants. Ces effets ont notamment été étudiés par divers organismes scientifiques, dont l’IFREMER, l’INRAE, l’IRSTEA et le CNRS, qui ont notamment publié en 2017 une expertise collective sur l’eutrophisation qui établit que cette perturbation du cycle de l’azote a des effets importants sur les écosystèmes aquatiques et marins, qui incluent les proliférations végétales parfois toxiques, la perte de biodiversité et des anoxies qui peuvent se traduire par la mort massive d’organismes aquatiques.
Une seule solution satisfaisante
En supposant qu’il soit techniquement et économiquement possible, le retrait des ulves ne réduirait pas significativement ces impacts. Eau et Rivières de Bretagne a rappelé sa position constante sur ce sujet : la seule solution satisfaisante sur le long terme au problème des marées vertes est la réduction des excès structurels d’azote relâchés dans les cours d’eau, qui se traduirait rapidement par la réduction et à terme la disparition des accumulations d’algues vertes, et donc la disparition des ressources dont la mission parlementaire étudie la valorisation.
En parallèle des efforts urgents de réduction, il est légitime de traiter les situations les plus urgentes, telles que les zones où l’accumulation des ulves présente des risques sanitaires (dégagement de H2S, en particulier). En attendant la disparition des dépôts dangereux, leur ramassage est une solution acceptable ; mais en quantité comme en qualité mais ne peut pas alimenter une filière économiquement durable de transformation à haute valeur ajoutée. En revanche, il est possible de les utiliser comme compost : cette exploitation « low-tech » et locale est sans doute la seule option économiquement viable. A défaut, elle devrait être financée sur la base du principe « pollueur-payeur », et non par les contribuables, « pollués-payeurs ».
Collecte difficile et couteuse
Néanmoins, Eau et Rivières de Bretagne a mobilisé ses experts, dont certains sont spécialisés dans l’exploitation des algues naturelles ou leur culture. Ces experts sont réservés sur les possibilités de collecter efficacement en mer ou sur les plages les proliférations d’algues, ulves et autres algues, sans nuire au milieu naturel, et en disposant d’une ressource de base de qualité acceptable pour être valorisable dans des chaînes de production. La collecte en mer, option à privilégier pour disposer d’une matière première de qualité, est difficile et coûteuse. Elle ne semble être économiquement valable que dans des conditions de flottation massives comme dans les Antilles. Pour les ulves, si ce recueil est réalisé à titre préventif en hiver, il ne peut produire que des tonnages très faibles, le résultat attendu (réduction des quantités d’algues vertes) allant à l’encontre des intérêts d’une filière industrielle. Par ailleurs, parmi les nombreuses algues dont la récolte ou la culture sont possibles sur les côtes bretonnes, les ulves sont parmi les moins intéressantes quelles que soient les applications (cosmétique, pharmacie, alimentation, nutrition animale, chimie verte), contrairement par exemple aux algues brunes. Finalement, le seul débouché identifié à ce jour semble être le compost.
Commencer par l'état de l'art
L’association relève que depuis au moins trois décennies des efforts sont menés dans le sens de la valorisation des ulves, mais qu’à sa connaissance tous les projets, pourtant généralement largement subventionnés par des fonds publics, se sont terminés par des échecs économiques voir la liquidation des entreprises concernées. La réduction espérée des ressources ne pourra qu’aggraver les bilans. La mission parlementaire devrait commencer par établir un état de l’art des expérimentations conduites depuis des décennies, et des moyens publics qui y ont été consacrés en vain.
Ce constat ne s’applique pas heureusement aux activités de production ou de prélèvement dans des écosystèmes en bonne santé : les algues marines autres que celles issues de l’eutrophisation constituent certainement une ressource prometteuse, pour peu qu’elles soient exploitées de manière durable. Pour ce qui concerne les macroalgues, qu’elles soient vertes, brunes ou rouges, il faut noter que l’échouage entraine de facto la perte du label bio des zones de récoltes des algues sauvages, car les algues « bio » doivent être récoltées dans une zone dont le classement DCE est « très bon état écologique », ce qui n’est pas le cas pour les masses d’eau concernées par l’eutrophisation.
C’est à notre avis à juste titre que la récente « feuille de route nationale pour le développement de la filière algue française » n’envisage pas de développement de la valorisation des algues épaves comme les marées vertes bretonnes.
La Bretagne n'est pas les Antilles
Au bilan, l’association considère que, contrairement aux Antilles où les îles sont pour les accumulations de sargasses essentiellement les victimes indirectes d’une combinaison d’effets naturels, de conséquences du changement climatique et des politiques agricoles menées dans d’autres pays comme le Brésil, on dispose en Bretagne de tous les leviers pour faire cesser ces proliférations, et que c’est donc cette option qui doit y être favorisée.
Il conviendrait notamment de réserver les financements publics à la lutte contre l’eutrophisation, et non de les orienter avec vers actions de valorisation des ulves très probablement non viables économiquement et qui entreraient forcément en conflit avec les projets de réduction de leur production en donnant un prétexte pour ne rien faire à tous les partisans d'un modèle agricole produisant des excès d'azote.