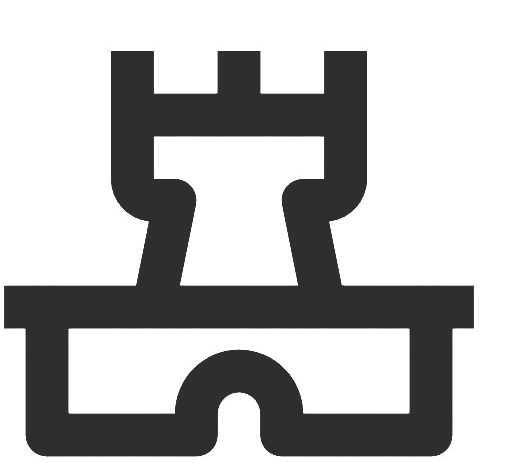Inondations : pour les limiter, protégeons les milieux naturels
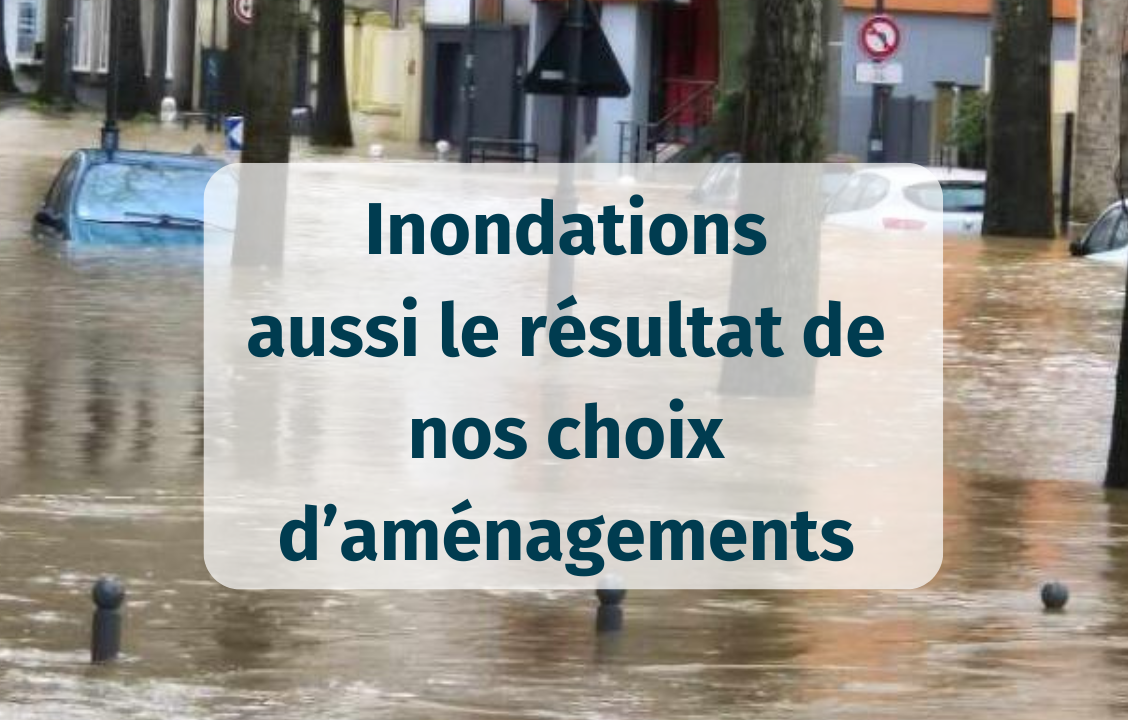
légende de la photo : à Rennes - rond point armand rebillon (au niveau de l'écluse Saint-Martin) le lundi 27 janvier 2025
Alors que depuis lundi, Vigicrue a placé une partie de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan en alerte rouge crues, Eau & Rivières de Bretagne tente d’analyser l’origine de cette crue exceptionnelle encore en cours, mais aussi les leçons que nous devons en tirer.
Une crue historique ?
En ce mardi 28 janvier, la majorité de la Vilaine et de ses affluents sont en vigilance orange inondations et depuis ce lundi 27 janvier, la Vilaine et la Seiche sont passées en vigilance rouge. Les conséquences sont déjà très importantes : maisons et routes inondées, habitants évacués...
Il a beaucoup plu depuis le 1er janvier : 135 mm en moyenne dans le département, soit trois fois plus que la moyenne entre 1997 et 2022. À Rennes, Météo Bretagne a déjà comptabilisé 170 mm de précipitations pour le mois de janvier. Le record mensuel absolu pour la station est de 193,6 mm (en octobre 1966) et pourrait être dépassé d'ici mercredi. On se rapproche, sur certaines rivières, des niveaux d’eau atteints lors de l’hiver 2000-2001. La situation annoncée est d’autant plus préoccupante qu’une « rivière de précipitations » est en place, avec des ondées plus brèves mardi, mais surtout qu’un événement de l’ordre de 18 mm est attendu ce mercredi, alors qu’une première décrue sera à peine esquissée.
Les inondations : Un phénomène naturel aggravé par nos choix d’aménagements
L’inondation est de loin le premier risque naturel auquel doivent faire face les Bretons, de part sa fréquence (3 847 arrêtés inondations ont été actés depuis 1982) et l’importance des dommages qu’il provoque. Mais si les inondations ont des causes naturelles, nos activités humaines viennent les aggraver, que ce soit par l’impact du changement climatique ou par l’aménagement du territoire. Ainsi, depuis 60 ans en Bretagne, la moitié des zones humides ont été détruites, le bocage a régressé et l’urbanisation s’est faite, en partie, dans des zones d’expansion de crues. Pauline Pennober, chargée de mission politiques de l’eau, précise que « en 50 ans, le bassin versant de la Vilaine a vu plus de 90 % de son linéaire retravaillé (rectification, recalibrage..), accélérant le cycle de l’eau. » Résultat, en 55 ans, le débit maximum annuel a augmenté de plus de 50 % sur le Semnon et 25 % sur le Meu, avec les conséquences que l’on observe aujourd’hui.

photo d'un recalibrage à Guipry en 1961
Nous constatons toujours une augmentation de l’imperméabilisation par la multiplication des zones d’activités et au sein des parcelles privés (parking privés, allées dallées...). Les aménagements urbains restent encore trop minéraux, même si des évolutions se mettent en place. Tout cela contribue à augmenter le ruissellement, en particulier pour des pluies plus que décennales. Or, une des conséquences du changement climatique est la diminution du célèbre crachin breton et l’augmentation des pluies importantes.
La crue est un phénomène nécessaire à la migration de certains poissons, comme les saumons ou les anguilles. Les débits importants en hiver permettent de décolmater les cours d’eau, d’apporter des nutriments indispensables au fonctionnement des estuaires et des activités économiques qui en dépendent. Les milieux humides liés à des débordements réguliers sont des espaces riches en biodiversité et qui limitent l’impact de ces mêmes inondations.
Les préconisations d’Eau & Rivières de Bretagne
Nous devons accepter les crues comme un phénomène naturel
C’est l’humain qui choisit le risque en implantant logements et activités dans les zones inondables, dont la cartographie est pourtant bien établie. Cette localisation qui comporte des inconvénients a parfois été acceptée dans les siècles passés, en particulier du fait de l’existence de ponts ou de gués permettant le franchissement des rivières. Mais notre époque a surtout voulu ignorer cette réalité et s’étonne des dommages. Rappelons la situation de Redon et ses activités dans une zone connue pour être une zone très inondée !
Il faut renforcer les outils d’urbanisme
Il faut aussi définitivement interdire l’urbanisation dans les zones encore peu ou pas urbanisées et sujettes à inondations. À ce titre, Eau & Rivières soutient la proposition du SAGE Vilaine limitant l’urbanisation de ces zones. Au contraire, nous dénonçons les projets qui envisagent encore d’urbaniser dans ces zones (projet Saint-Grégoire alors même que dans les terrains voisins, les caves sont inondées depuis quelques jours). Il est indispensable de programmer un transfert progressif des activités et habitations hors des zones les plus inondables et submersibles.
Nos modes d’occupation du sol sont aussi à interroger
La progression des cultures, en particulier du maïs, au détriment des prairies, n’est pas sans effet sur l’infiltration et le ruissellement. Il faut augmenter les budgets des aides européennes aux agriculteurs qui maintiennent des systèmes herbagers, entretiennent les zones humides, plantent des haies... A ce titre, Eau & Rivières de Bretagne accompagne les agriculteurs à travers des "chantiers bocage collectifs".
En savoir plus sur le projet les mains dans le bocage
Il faut promouvoir les solutions fondées sur la nature !
Les aménagements dits « durs » (chenalisation, recalibrage, endiguement…), implantés dans l’optique d’une réduction locale et d’une protection ponctuelle des effets des crues, ont pour conséquence d’accélérer l’eau et donc d’aggraver la situation à l’aval. Ces dispositifs sont coûteux économiquement et ne permettent pas de faire face aux crues les plus importantes. L'option des « barrages » a des limites, catastrophiques lorsqu’elles sont dépassées : c’est une fausse bonne solution. Plusieurs solutions moins impactantes, moins coûteuses et/ou apportant un bénéfice écologique existent : restauration d’habitats, maintien des zones humides, valorisation du bocage, augmentation du potentiel de rétention des sols agricoles... La restauration écologique des cours d’eau doit être menée en parallèle de la préservation des zones d’expansion naturelle des crues (zones inondables, zones humides) et des autres infrastructures naturelles des bassins versants (haies, talus, forêts…) qui jouent un rôle primordial dans le stockage et la rétention de l’eau. La qualité des eaux de nos rivières y gagnera aussi. À l’humain aussi d’accepter qu’il a été sur la lune, mais que la nature est plus forte que lui.
Mettre en place une solidarité amont-aval
Les SAGE et les collectivités devront intégrer cet aspect de solidarité amont-aval et faire valoir leur vision globale du territoire et du bassin versant.
Nicolas Forray, secrétaire général et hydrologue, conclut que « pour Eau & Rivières, il faut une gestion intégrée du territoire et de son occupation, des sources à l'estuaire. Pour que chacun, à son niveau, prenne la pleine mesure des conséquences de ses pratiques sur la collectivité dans son ensemble ».
Quelques définitions :
-
Une crue est un phénomène naturel caractérisé par une montée du niveau des cours d’eau, en raison de précipitations très abondantes. La fréquence, l’intensité et la durée des crues dépendent de nombreux facteurs : cumul des pluies sur les semaines précédentes, saturation des sols, caractéristiques structurelles des bassins versants (exemple : formes des vallées, pente du cours d’eau…), aménagements qui y ont été menés (destruction des zones humides, urbanisation en zone inondable, destruction du bocage,…).
-
Une inondation est un débordement d’eau qui submerge un territoire, consécutivement à une crue. Une inondation peut avoir plusieurs origines (débordements de cours d'eau, submersions marines, ruissellements, rupture ou défaillance d'ouvrages hydrauliques…).
-
Une rivière de précipitation : C’est un terme de météorologie, qui désigne une zone pluvieuse ondulante qui fonctionne pendant plusieurs jours.